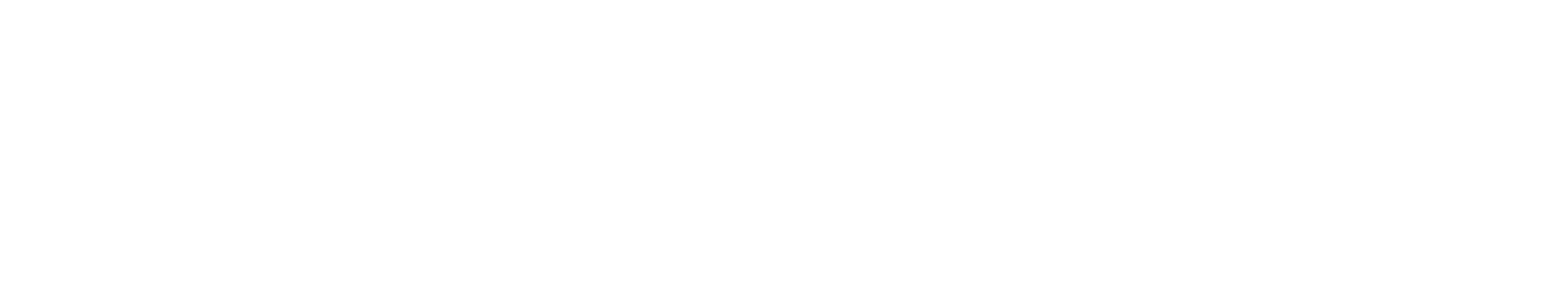Râcla ou la raclette élevée au rang des Beaux-arts
Julie Langenegger, Râcla, 2019. Négatif 4’/5’ numérisé, dimensions variables
« Manger avec...», c’est apprendre à vivre en société, à respecter des règles, des rites et des rythmes, à réfréner ses pulsions en produisant du lien pour contribuer à la cohésion sociale. Le fait de dîner ensemble permet de s’assurer de l’appartenance à un groupe, un milieu ou un clan. Le partage de la chère a valeur de rite qui sert à « prouver que nous ne sommes ni des arsouilles, ni des animaux, et que nous formons encore une société humaine. »[1] Déjà, Claude Lévi-Strauss considérait que la manière dont les gens préparent les aliments[2] est une sorte de langage[3] servant à communiquer, à un niveau inconscient, la structure d’une société.
Les différents sens et fonctions que peut revêtir la nourriture, de même que la place qu’elle occupe dans l’art à travers les siècles, n’ont pas manqué de questionner Julie Langenegger Lachance. Avec Râcla[4], elle revisite le genre classique de la nature morte[5] en lui apportant une touche personnelle qui frappe immédiatement le spectateur. Elle nous offre une représentation classique de la raclette, cette demi-meule de fromage[6] placée sous la chaleur d’un four électrique. Servi avec des pommes de terre, des cornichons et des petits oignons, ce mets typique valaisan se déguste lors des fêtes populaires, accompagné d’un verre de fendant. Ici, le fromage entamé, en train de tiédir, apparaît comme figé dans son « mouvement » de fonte, tandis que les assiettes vides gardent des traces du repas et qu’une empreinte de rouge à lèvres subsiste sur le verre à pied en cristal renversé. Julie Langenegger Lachance saisit ainsi la raclette, tout juste consommée. En immortalisant les reliefs du souper, la photographe s’attache à transmettre un caractère vivant, organique et charnel à la scène et transfigure ce moment fugace en une oeuvre pérenne. Contrastant avec la solidité apparente de l’appareil chauffant qui suggère une forme de permanence, la fragilité des fleurs fraîches (pivoines, renoncules, fleurs de cire et chardons), la montre à gousset et la petite souris grise gisant sur le four, au-dessus de la meule, alimentent un propos métaphorique sur l’éphémère, la fuite du temps, la dégradation inhérente à l’existence et l’inéluctable mort. A l’opposé, les plaisirs de la vie symbolisés par le raisin - fruit emblématique du Valais -, la bouteille de vin blanc et la petite flasque d’eau-de-vie offerts au regard peuvent paraître futiles, face au trépas qui attend chacun de nous.
A l’instar des peintres[7] disposant les éléments de leur futur tableau, la photographe obéit aux codes d’une composition soigneusement élaborée préalablement à la prise de vue à la chambre technique 4/5 inch. L’agencement suit un principe de désordre organisé qui vise à produire une impression de naturel à travers la juxtaposition en apparence aléatoire des objets, en réalité placés harmonieusement selon des règles rigoureuses. À la manière des peintures néerlandaises du 17ème siècle, la lumière venant de gauche projette un halo sur cette vision. De par sa place essentielle dans la construction de l’image, le clair-obscur renforce l’atmosphère mystérieuse et souligne textures et volumes en conférant une dimension quasi sculpturale aux éléments. La mise en lumière précise et raffinée magnifie les matières précieuses : souplesse de la nappe en lin, brillance des couverts en argent et de la montre à gousset, transparence délicate du cristal et du verre ou éclat des graciles et élégants pétales de fleurs. Le fond noir qui épure l’ensemble met en valeur par contraste tous les composants. Ainsi sublimée, la demi-meule à la pâte dorée, souple et onctueuse, déploie son volume sensuel, invitant à la gourmandise.
En s’emparant d’une spécialité culinaire du Valais, Julie Langenegger Lachance, grâce à une exquise mise en scène, l’élève à un niveau universel, au-delà de ce que ce plat comporte à la fois d’emblématique et de « terrestre ». Telle une Vanité[8] contemporaine qui insuffle au réel une portée allégorique, cette photographie d’inspiration très picturale interroge le subtil point de basculement entre le vivant et l’inerte et invite à une méditation sur le caractère fugitif de l’existence.
[1] François Nourricier, « Éloge des dîners en ville », Madame Figaro, 1er décembre 1990.
[2] Dans l’oeuvre de Claude Lévi-Strauss, la nourriture occupe une place considérable.
[3] Un langage dans lequel cette société « traduit inconsciemment sa structure, à moins que, sans le savoir davantage, elle ne se résigne à y dévoiler ses contradictions » (Claude Lévi-Strauss, Mythologiques Volume 3. L’origine des manières de table, Plon, Paris, 1968, 552 p.)
[4] Le mot raclette dérive du patois bas-valaisan « râcla » qui signifie « racler ».
[5] L’expression « nature morte » apparaît en France au XVIIIème siècle lorsque Diderot parle dans ses Salons - oeuvre pionnière dans l’exercice de la critique d’art - de « nature inanimée ». Apparue en Flandre vers 1650, l’appellation stilleven, qui sera ensuite adaptée en anglais pour donner still life, peut se traduire par « vie immobile ».
[6] Une demi-meule de Bagnes 4, importée au Canada depuis le Valais.
[7] La photographe s’est notamment référée à Floris van Schooten (1590-1655), peintre néerlandais du siècle d’or, connu pour ses peintures de natures mortes, telle Nature morte au jambon ; Pieter Claesz (1597-1661), autre peintre de natures mortes néerlandais de la même période, représentant du baroque.
[8] En peinture, la vanité est un genre pictural, appliqué aux natures mortes, évoquant différents éléments symbolisant la vie, la nature, l’activité et la mort. Ces tableaux ont généralement une grande valeur symbolique et philosophique telle que la Vanité ou Allégorie de la vie humaine (1646) peinte par Philippe de Champaigne durant la première moitié du XVIIème siècle.